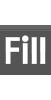François Migeot
Président du CRL Franche-Comté de 2002 à 2013
« Novembre, le mois des silhouettes »
José Antonio Ramos-Sucre
Besançon. Petites Fugues. Une cour à la lueur incertaine de novembre. C’est le Palais Granvelle et ses arcades où le soleil hésite. Ou encore, une autre année, c’est la Place de la Révolution, son musée, le battement fébrile de ses portes vitrées et, face à face, ses deux escaliers prêts à conduire la foule. Dehors des groupes animés se font, se défont — pardessus, manteaux et bonnets —, des visages animés, rayonnant encore des lumières de la lecture, des mains qui expliquent, des voix qui s’échauffent.
On est passé de la nuit au grand jour, du texte au visage des écrivains. Ils sont là, ils qui naviguent dans l’assemblée en archipel qui s’ouvre et se referme à leur approche. On échange, à chaud, à vif, avant le retour à l’obscurité. Descendus de la statue qu’on leur a fabriquée, ils répondent aux questions, sourire et courtoisie au visage. On compare l’original de l’auteur avec la copie qu’on gardait des photos, ou avec celui que lentement la lecture de ses textes tissait sous les yeux.
Puis c’est à nouveau le moment de reprendre sa place et de laisser l’obscurité opérer. Les lumières baissent dans la salle, les somptueux tableaux sur les murs se fondent à nouveau dans l’ombre, il n’en reste qu’une vague rêverie. Le silence s’étend de proche en proche. Ne restent, sous la chaude flamme des projecteurs, qu’un micro, puis une silhouette, feuillets à la main, qui regarde par-dessus les têtes.
Puis une voix. Elle occupe tout l’espace et les mots dessinent peu à peu leurs figures, un monde s’esquisse, prend lentement forme au train ralenti des phrases. On ne voit plus que ce visage, faible veilleuse qui déploie l’invisible des pages.
On se tient au grain de la voix. On laisse monter en soi les images, les lieux, les personnages, les pensées. On ne voit rien, on imagine, on construit l’impalpable. Le miracle de la littérature. Elle fait de notre esprit son théâtre, mobilise tous nos cintres intérieurs, tous les décors que la vie a remisés et que la parole déroule à nouveau derrière nos yeux mi-clos. Puis le charme se rompt. C’est le réveil des lampes. La lumière du réel.
Le démiurge apparaît, guidé par son ange gardien qui va modérer l’entretien. Deux fauteuils, un cercle jaune les contient. Ils vont parler de l’entendu. Du travail de la plume. L’édifice nocturne s’efface devant la clarté de l’explicite. On se demande parfois si le mystère de l’ombilic du rêve n’avait pas plus de charme que l’explicitation des travaux du chantier. Écrire est une chose ; raconter l’écriture en est parfois une autre… Heureusement le livre en sait toujours plus que son auteur. On ne lèvera qu’un coin du voile.
Reste à descendre au grand jour des lampes qui éclipsent la tombée du soir où la ville se recueille derrière les vitres. Elles détaillent les étals, les piles de livres à l’ombre desquels les auteurs fêtés se tiennent en retrait. On achète, on demande une signature, mieux, une dédicace, on donne un nom, un prénom. Un peu d’encre et quelques mots, noirs d’empathie, resteront de cette traversée claire-obscure.
Puis le livre trouvera asile et patientera sur les rayons d’une étagère. On le reprendra peut-être un jour, pour aller plus loin dans le destin des images, aussi, sans doute, pour essayer de retrouver dans les lignes le grain d’une voix disparue à laquelle il faudra suppléer par une autre, intérieure. Et c’est la nôtre qui remontera peu à peu des pages. Elle aura à se mesurer à l’empreinte de celle des comédiens. La déception menace. Mais le livre, s’il met en branle la pâleur de la page, aura prouvé qu’il avait une âme.